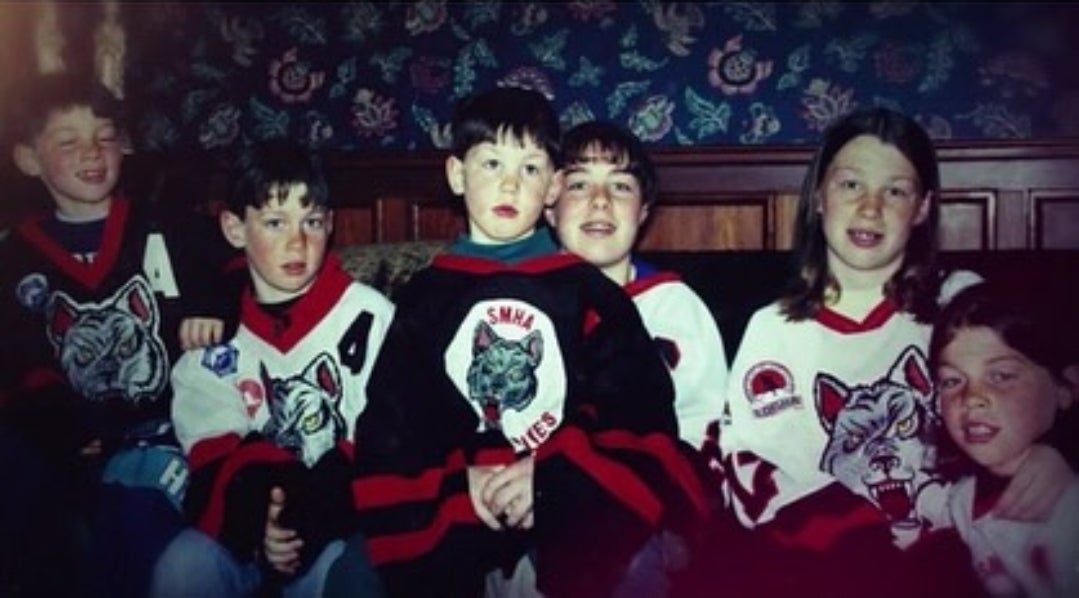Vancouver, fin des années 1970. La jeune Laura Bennion, sept ans, veut
jouer au hockey mineur.
Sa mère Glenda et elle font la queue à l’aréna local pour l’inscription.
Leur tour venu, elles apprennent que Laura n’est pas autorisée à jouer au
sport qu’elle aime.
« J’étais un vrai garçon manqué, alors ma présence n’était pas si incongrue
», raconte Laura. « Au comptoir d’inscription, ma mère a commencé en
donnant mon nom et tout. Son interlocutrice m’a regardée puis s’est tournée
vers ma mère, déclarant que les filles n’étaient pas admises dans la ligue.
“Les filles ne jouent pas au hockey”. »
Cette expérience aurait pu éloigner la petite Laura du hockey pour de bon.
Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Tandis que Laura et sa mère s’écartent
pour envisager la suite, Keith Morrison, un entraîneur d’une équipe locale
de hockey mineur, interpelle Glenda et lui propose d’offrir une place à
Laura dans son équipe.
Morrison s’impliquait depuis longtemps au hockey mineur dans la communauté.
Lui-même joueur, il avait aussi contribué à rassembler un groupe d’amis de
l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) pour former une équipe, les
Flames Oldtimers de Vancouver. Morrison, qui est décédé au mois de janvier
dernier, a été intronisé au Temple de la renommée de la Canadian Adult
Recreational Hockey Association en 1998. Il occupe les pensées de Bennion
ces jours-ci, lui qui a été le premier à lui donner sa chance au hockey et
lui a permis de développer une passion durable pour ce sport.
« Morrison a dit, “On va s’arranger, on écrira Larry sur son casque pour
qu’elle joue dans mon équipe” », se remémore Bennion. « Son fils avait le
même âge que moi, nous avions fréquenté l’école de hockey ensemble.
Morrison m’avait vu jouer, bien que ça ne soit pas vraiment déterminant à
sept ans. J’ai donc joué sous le pseudonyme de Larry pendant toute la
première année, et vers la fin, la rumeur quant à ma véritable identité a
commencé à circuler. C’est comme ça que j’ai commencé à jouer. »
Toute jeune, Bennion semblait destinée à évoluer dans le monde du hockey
toute sa vie. Sa mère Glenda, qui habite toujours dans la région de
Vancouver, raconte que, petite, Laura passait des heures à jouer sur la
terrasse de béton dans la cour arrière, criant « Le tir, et le but! ».
« Elle aime le hockey depuis son plus jeune âge. Et ça ne vient pas de moi!
», dit-elle en riant. « Son père est décédé d’une tumeur au cerveau quand
elle avait cinq mois. Il était un fervent amateur de hockey. Son équipe
préférée était les Maple Leafs de Toronto. Il n’a jamais eu la chance d’en
discuter avec sa fille, alors je présume que c’est génétique. Je pense que
l’amour du hockey était inné chez elle, qu’elle avait ça dans ses gênes. »
Aujourd’hui, Bennion a 50 ans et est une médecin réputée qui vit à Calgary,
où elle partage son temps entre la médecine familiale, l’obstétrique et la
gynécologie, et la médecine sportive. Son mari, Ian Auld, est le médecin
d’équipe des Flames de Calgary. Le couple a deux enfants : Evan, 15 ans,
qui joue au hockey à l’Edge School For Athletes, et Carys, 11 ans, qui est
une joueuse passionnée de volleyball et de softball.
La passion de Bennion pour le hockey ne s’est jamais estompée, et le sport
occupe toujours une place importante dans sa vie. Après sa première année
sous le pseudonyme de Larry, elle s’est jointe à une ligue pour filles dans
la vallée du bas Fraser, où elle a évolué tout au long de sa carrière au
hockey mineur. Adolescente, Bennion a développé un intérêt marqué pour le
basketball (dans lequel elle voyait davantage de possibilités qu’au hockey)
et a joué dans l’équipe de son école secondaire. Ensuite, elle a joué
pendant deux ans pour l’équipe féminine de basketball de l’UBC, pensant que
sa carrière au hockey était terminée.
Et pourtant…
« Je me suis disloqué l’épaule, ce qui m’a causé des problèmes », explique
Bennion. « Il est devenu évident que le basketball, où on a souvent les
bras au-dessus de la tête, me rendait vulnérable. Que ce n’était pas le bon
sport pour moi et que le hockey était sans doute mieux. J’ai appris qu’il y
avait quelques équipes universitaires dans l’est des États-Unis, alors j’ai
communiqué avec l’équipe Northeastern, à Boston, où j’ai suivi les
troisième, quatrième et cinquième années de mes études de premier cycle en
journalisme. Je me suis fort heureusement retrouvée dans un très bon
programme de hockey. »
Bennion est ensuite rentrée en Colombie-Britannique pour étudier la
médecine à l’UBC. Elle a joué un rôle déterminant dans la création d’une
équipe de hockey féminin à l’université en 1994, ralliant des joueuses sur
le campus et contribuant à l’essor de la formation, qui est devenue plus
tard une puissance du niveau postsecondaire. Au départ, Bennion a été
entraîneuse pour l’équipe de l’UBC. Puis, comme elle y était toujours
admissible, elle s’est jointe à titre de joueuse pendant trois saisons
(1996-1999).
Celle qui a évolué à l’avant et en défensive durant sa carrière
universitaire a fait le camp d’essai de l’équipe nationale féminine du
Canada à deux reprises, notamment au milieu des années 1990 avant les Jeux
olympiques de Nagano de 1998.
Son apport à la création de l’équipe féminine de l’UBC a été si déterminant
que Bennion a été intronisée au Temple de la renommée des sports de l’UBC
en 2014.
Elle est toujours active. Son mari Ian et elle sont des mordus de cyclisme
et font beaucoup de vélo de route et de montagne pendant les mois de
printemps et d’été. De plus, le hockey occupe encore une place de choix
dans sa vie. Bennion est médecin pour l’équipe nationale féminine du Canada
et a travaillé avec l’Inferno de Calgary quand celle-ci faisait partie de
la Ligue canadienne de hockey féminin, depuis les débuts de la formation
sous le nom d’Équipe Alberta.
Elle est aussi copropriétaire d’un cabinet de médecine familiale à Calgary,
œuvre dans le monde de la médecine sportive à la clinique Group 23 et
pratique des accouchements. Bennion aime la diversité de son travail.
Quand on lui demande la recette de son succès, elle répond ceci : « Je
crois que je suis une personne plutôt équilibrée. Je ne suis pas facilement
déconcertée. Ça aide. Le fait de m’impliquer dans toutes ces sphères y est
probablement aussi pour quelque chose. Une foule de trucs m’intéressent. Je
ne suis pas du genre à mettre tous mes œufs dans le même panier. La
diversité me nourrit profondément. »
« Je n’avais jamais vraiment remarqué de parallèle entre la médecine
sportive et l’obstétrique, mais en fait, il y en a beaucoup. En médecine
sportive, on traite des gens qui tentent de repousser les limites de leur
corps, et ça ne se passe pas toujours bien. En obstétrique, la grossesse et
l’accouchement sont évidemment l’un des plus grands défis qu’une mère vivra
sur le plan physique dans sa vie. On trouve bel et bien des similitudes
entre les deux. »